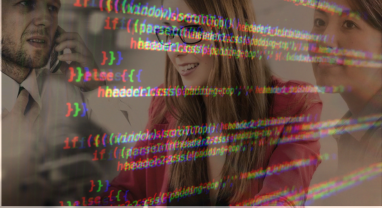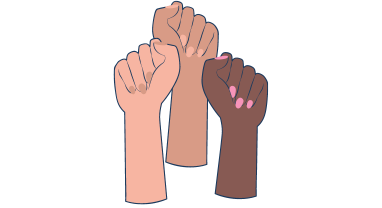La procrastination est souvent considérée comme un comportement improductif et inefficace. Cependant, la réalité est un peu plus complexe. La procrastination peut en fait se révéler être une compétence indispensable. Alors quels sont les avantages de la procrastination ? Comment la science peut-elle nous aider à comprendre ce phénomène ? Comment différencier la procrastination de la paresse ? Et enfin comment transformer la procrastination en une compétence essentielle ?
Réponses, dans cet article à lire… dès maintenant !
La procrastination est généralement perçue comme un comportement improductif, mais elle offre pourtant de nombreux avantages. Tout d’abord, elle aide à améliorer sa créativité. Lorsque nous procrastinons, notre cerveau a plus de temps pour faire des connexions entre des idées apparemment disparates. Cela peut conduire à des approches plus créatives et innovantes.
C’est aussi un bon ingrédient s’agissant de réduire le stress. Lorsque nous sommes submergés par une tâche, nous avons souvent tendance à nous sentir stressés et anxieux. En “gagnant” le temps précieux offert en procrastinant, nous pouvons nous détendre et nous ressourcer mentalement. Cela peut nous aider à aborder la tâche avec un esprit plus clair et plus détendu.
Enfin, la procrastination peut avoir un impact positif sur la qualité du travail. Lorsque nous procrastinons, nous avons plus de temps pour réfléchir à la tâche et à la meilleure façon de l’accomplir. En repoussant une tâche, on se prépare ainsi à la réaliser plus efficacement. Cela peut conduire à un travail plus réfléchi et plus soigné. Avec tant d’avantages, l’intérêt de procrastiner semble se dessiner…
La procrastination est souvent considérée comme un comportement irrationnel et autodestructeur. Mais une étude publiée fin 2022 nous donne un autre éclairage sur ce phénomène. L’imagerie a montré que le cortex cingulaire antérieur est la région cérébrale activée lors de la prise de décision. Cette zone est responsable de l’évaluation des avantages et des inconvénients de chaque option en termes de coûts (efforts) et de bénéfices (récompenses) potentiels. Que se passe-t-il dans le cas de la procrastination ? Est-ce un dysfonctionnement de cette région du cerveau ? En réalité, une tâche peut générer des émotions négatives. Ces dernières détournent alors l’attention de la tâche à accomplir et suscitent une forme de désengagement. Le cerveau évalue le coût et les bénéfices au regard d’une tâche, perçue comme désagréable, menaçante ou difficile. Ce conflit émotionnel est résolu en reportant la tâche. Les tâches agréables ou faciles seront donc moins enclines à être reportées.
Lorsqu’on a des difficultés à organiser son temps, ces fameuses émotions négatives peuvent surgir pour des tâches qui dans un autre contexte ne poseraient pas de problème. Dans un agenda surchargé, une tâche supplémentaire pourra – même si elle était simple et agréable à réaliser – se retrouver procrastinée du fait de ce conflit émotionnel. Les personnes qui rencontrent des difficultés pour gérer leur temps sont donc plus susceptibles de procrastiner. C’est la conséquence d’un sentiment de submersion occasionné par les tâches à accomplir ou les difficultés à prioriser les actions.
Dernière dimension pouvant impacter les émotions et susciter de la procrastination : les problèmes de motivation. Les personnes qui ne sont pas motivées ou qui ne voient pas l’intérêt de la tâche ont souvent tendance à procrastiner. Cela peut provenir d’un manque de clarté sur les objectifs à atteindre, d’une mauvaise communication sur les enjeux, ou encore d’un manque de sens dans l’activité à réaliser. Autant de cause qui génèrent des émotions négatives autour d’une tâche, contribuant à déclencher la procrastination.
Ainsi, la procrastination est souvent une réponse à des mécanismes émotionnels, cognitifs et comportementaux.
La procrastination est parfois confondue avec la paresse. La paresse est le comportement d’une personne qui préfère systématiquement éviter l’effort. La procrastination, en revanche, est un comportement qui consiste à reporter une tâche à plus tard quand notre cerveau juge que l’effort nécessaire n’est pas à l’instant T suffisamment pertinent au vu des bénéfices escomptés. La procrastination est donc par essence sélective là où la paresse est plus systématique. Et c’est cette sélectivité que l’on va pouvoir travailler pour rendre la procrastination utile voire indispensable.
L’idée va être de mieux maîtriser ce phénomène qui est au départ géré par notre cerveau sur la base d’émotions générées par une tâche. De mieux piloter ses choix en maîtrisant efficacement les émotions créées par telle ou telle action à réaliser. En utilisant des stratégies de gestion du temps efficaces, on va ainsi pouvoir réduire l’émotion négative générée par la difficulté apparente d’une tâche. Et choisir au vu d’éléments factuels (objectifs, priorités, ressources…) quelles tâches doivent être réalisées et quelles tâches peuvent être reportées. En clair, la procrastination devient une compétence quand on maîtrise son fonctionnement. Que l’on ne procrastine pas tout et n’importe quoi. Bienvenue dans l’ère de la procrastination consciente.
Différents stratagèmes peuvent être mis en place pour maîtriser les émotions déclenchées par les tâches à traiter. Pour les rendre moins intimidantes, on peut par exemple décomposer les tâches en petites étapes réalisables. Les tâches complexes peuvent souvent sembler insurmontables, ce qui peut entraîner une tendance à les éviter alors qu’elles sont peut-être importantes pour vous. On peut aussi s’habituer à se fixer des délais réalistes pour chaque étape de la tâche. Cela peut aider à maintenir la motivation et à éviter cette fameuse procrastination automatique fruit de nos émotions. Enfin, prendre des pauses régulières pour éviter la fatigue mentale et physique vous permettra de mieux maîtriser votre tendance à procrastiner. Quand on fatigue, une tâche supplémentaire aura davantage tendance à générer des émotions négatives.
La procrastination efficace consiste à utiliser le temps de manière productive plutôt que de le gaspiller. Il est possible de concilier productivité et procrastination en utilisant certaines stratégies. Tout d’abord, déterminer les moments de la journée où nous sommes les plus productifs et travailler pendant ces périodes. Ensuite, profiter du temps libéré par la procrastination de façon pertinente. Par exemple, prendre une pause pour faire de l’exercice ou pour lire un livre peut aider à stimuler la créativité et à réduire le stress. Enfin, il est important de fixer des limites pour que la procrastination ne dérive pas. Par exemple, fixer une heure maximale pour commencer une tâche peut aider à maintenir la motivation.
Enfin, procrastiner peut entraîner de la prise de retard sur certaines missions, générer de la culpabilité, de l’inquiétude. Autant de conséquences qui peuvent accroître stress et anxiété. Gardons donc en tête que la clé de la procrastination est sa maîtrise, de façon à ne pas se laisser submerger par ses conséquences négatives. Maîtrise issue d’une compréhension de son mécanisme.
En véritable compétence, la procrastination devient un atout considérable dans un fonctionnement quotidien efficace et durable. Quand elle est consciente et maîtrisée, elle peut avoir bien plus d’avantages que d’inconvénients. Repousser des tâches, oui. Mais pas n’importe lesquelles, et pas pour “perdre” le temps ainsi “gagné”.